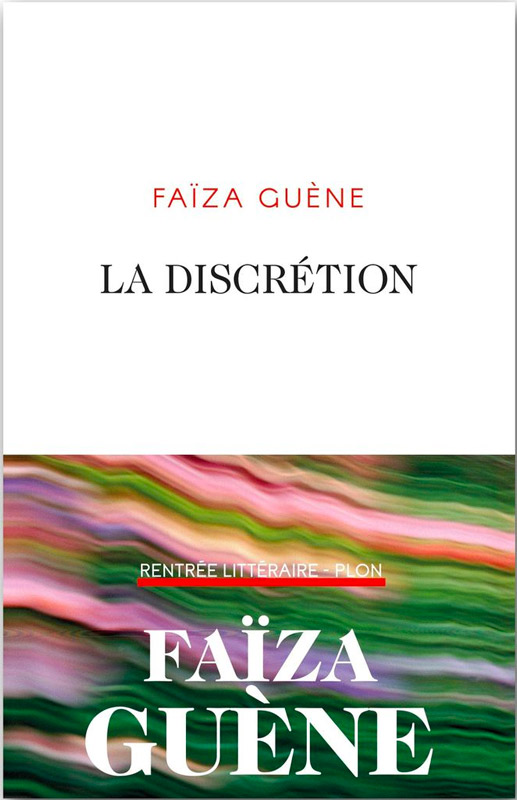
La discrétion est un livre attachant dédié à la mère de l’auteure et à toutes nos mères. J’ai rarement lu une dédicace si juste et si sincère. « À son cœur qui déborde comme la Méditerranée. […] À ses sacrifices qui n’ont pas été vains ». Notons qu’elle dédie son livre aussi à son père « mort de discrétion ».
Ma journée de vacances semblait dédiée à l’écriture de mon prochain ouvrage, mais mes yeux sont tombés sur ce livre que j’avais acheté. J’avais lu simplement quelques lignes sans pouvoir aller plus loin durant ces dernières semaines trop pleines. Je me suis jetée dedans comme on se jette dans la Méditerranée, en sachant que j’allais le lire d’une traite, d’un souffle. Sans m’arrêter pour manger, ni pour répondre au téléphone, pour rien… Cela je le savais, car j’avais entendu Faïza Guène en parler. Je connais Faïza Guène depuis son premier livre Kiff, kiff, demain, paru chez Fayard en 2004, et je sais sa capacité à dire les questions transculturelles. Mais ce que je n’avais pas anticipé, c’est l’émotion qui m’a étreinte à l’évocation de Yamina, cette mère, notre mère, ma mère… Faïza Guène raconte comment elle a été « prise » par le mot discrétion, tellement adapté à sa mère, et comment de ce mot est né le livre. Plusieurs de mes proches de l’équipe transculturelle qui ont lu le livre avant moi, je pense par exemple à Amalini Simon, m’avaient dit combien ce mot était bien trouvé pour parler des mères migrantes, qu’elles viennent d’Algérie comme Yamina, du Maroc, du Sri Lanka ou encore d’Inde. Fatima Touhami, à qui j’avais parlé de ce livre, m’a appelée pour me remercier de lui avoir parlé de ce livre avant même de l’avoir lu moi-même !
Discrètes et par là même rebelles, ces femmes migrantes, ces mères sont déterminées, résistantes, passionnées, croyant dans les valeurs de la vie et de la transmission. Mais ce livre est aussi un livre sur la seconde génération avec cette belle phrase de Fanon, tirée de son livre Les Damnés de la Terre, qui ouvre la seconde partie du roman : « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». On y suit le destin d’Omar, d’Imane, de Malika ou d’Hannah, les enfants du couple Taleb, Yamina et Brahim. Tous les enfants doivent trouver une voie, leur voie qui n’est pas la même que celle de leurs parents et qui diffère aussi pour chaque enfant de la fratrie. On le perçoit, les garçons et les filles intègrent différemment cette complexité transculturelle (j’aime beaucoup cette idée de complexité plutôt que de choix). Mais pour tous se pose la question de l’alliance : avec qui se marier ? Qui passera le test du sedari (banquette marocaine) ? Quelle personne pourrait s’asseoir sur le sedari de mes parents, que cela soit possible et que tout se passe bien ? Seul finalement Omar, chauffeur de taxi Uber la nuit, semble pourvoir l’envisager, même tardivement. Le livre ne nous donnera pas l’opportunité de savoir si la jeune fille, Nadia, qui elle n’a pas envie qu’on discute sa place dans le monde, passera le test avec succès.
On va de la wilaya de Tlemcen, Msirda Fouaga au Nord-Ouest de l’Algérie, berceau de la famille Madani, celle de Yamina, en passant par le Maroc avant d’arriver à Paris ou plutôt à Aubervilliers, dans des lieux que je connais et que je reconnais. Le livre voyage, en effet, entre le présent à Aubervilliers, le passé en Algérie, où se trouvait le figuier de Yamina, et le Maroc où sa famille a dû fuir pendant la guerre d’indépendance algérienne. Heureusement, le hasard a généreusement donné à Yamina un nouveau figuier dans les jardins ouvriers d’Aubervilliers, appelés Jardins des vertus, comme se nomme l’association qui les gère. Depuis la lecture de ce livre, quand je passe devant les jardins en bicyclette, tous les mercredis matin, je pense à Yamina qui aime tant les fleurs.
Il y a dans ce livre une position politique au sens où nous l’entendons aussi en transculturel : l’intime est politique. Comment vivre dans l’exil, fruit de l’histoire ? Comment s’affilier par le mariage ? Comment travailler dans un monde où se pose la question de votre légitimité ? Comment pleurer ses morts ? À ce propos, après les attentats de Saint-Denis en 2015, la première réaction de la famille Taleb est : « Faites que ce ne soit pas un Arabe ». Car ce qu’ils redoutent avant tout, comme tant de migrants du Maghreb, c’est la désolidarisation, comme si les Français légitimes leur demandaient implicitement de descendre dans la rue, dans un cortège à part, celui des musulmans d’apparence, pour dire : « Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas comme eux », toujours pour reprendre les mots du roman. Et après chaque attentat, la question de la légitimité et de l’adhésion à la communauté française se pose. Pourtant, « un peuple uni ne se divise pas pour pleurer ses morts ». Apparaissent aussi les questions du rapport au religieux, au voile, aux langues maternelles, aux affiliations multiples. Sur la question des langues, j’ai sursauté quand Malika, salariée de la Mairie de Bobigny au service de l’état civil, est dénoncée par sa collègue antillaise Bianca – qui fait du zèle auprès du chef de service – pour avoir aidé un chibani, un vieil homme arabe, en lui parlant en arabe pour mieux comprendre ce qui lui arrivait et alors qu’il était perdu. Le commentaire d’Imane, la sœur de Malika, est sans appel : « Si tu avais parlé en anglais à un américain, tu aurais été félicitée, mais en arabe à un vieux monsieur en perdition, tu es blâmée ». C’est malheureusement souvent le cas dans notre beau pays qui a peur de ses langues et des liens à l’intérieur de certaines communautés. L’accueil, ou plutôt le mauvais accueil, de Yamina accompagnée de sa fille à la préfecture est également du même ordre. Que de malentendus et de rencontres ratées que Yamina encaisse avec discrétion, une discrétion qui s’apparente à une forme de résistance. Les métissages se font aussi, la preuve en est dans le roman, quand toute la famille Taleb part en vacances non pas en Algérie mais… en Charente. Les filles se baignent, mais pas devant leur père par pudeur. Yamina se baigne avec un burkini, elle en éprouve un grand plaisir et remercie le ciel car « les sacrifices n’ont pas été vains ».
Faïza Guène utilise tous les éléments à sa disposition, y compris typographiques avec un art subtil de l’utilisation de l’italique et des majuscules, pour nous permettre, voire nous obliger, de voir notre monde autrement. Elle dit relire son texte à haute voix et mettre en italique les mots sur lesquels elle a envie d’insister. Et la fiction sert ce projet.
Lisez ce roman, c’est un grand livre…
© 2025 Editions La pensée sauvage - Tous droits réservés - ISSN 2259-4566 • Conception Label Indigo