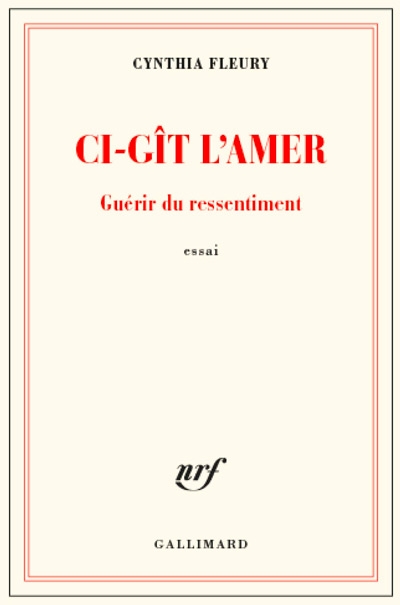
Dans Ci-gît l’amer, il est question de la clinique du ressentiment. Une équation littéraire à trois inconnues, ou presque : l’amer, la mère et la mer. Cet essai, dans la continuité des deux précédents de Cynthia Fleury Les pathologies de la démocratie (2005) et Les irremplaçables (2015), traite de la dialectique existante entre ces trois notions. Afin de pouvoir guérir du ressentiment et de voir plus loin, vers la mer, l’horizon, et non l’exil, il faut savoir apprécier l’amer. « La saveur de l’amertume », c’est avant tout l’amer de la séparation avec la mère, la protection infinie. Mais pour arriver à cette solution, de l’individu « ressentimiste » à l’analysant, tout le monde passe sur le divan.
Avec son approche de la philosophie politique et son orientation psychanalytique, Cynthia Fleury part de l’individu et non du leader ou du régime politique. Elle soutient ainsi que le concept du ressentiment est important à comprendre et à décortiquer, car c’est de cette dynamique que découle un régime politique libéral ou autoritaire, démocratique ou fasciste. Quelles en sont les causes ? Est-ce une question de génération ? De vie individuelle ? De leader charismatique ? De gestion des masses ? De névrose ou de psychose ? Ou encore d’une inaptitude à la liberté ? Exemple criant qui étaye sa démarche, le fascisme, résultante directe du processus « ressentimiste », voué à exister de nouveau car dépeignant une situation psychique et non pas historique. Elle y consacre une bonne partie de l’écrit, avec l’appui théorique d’Adorno, de Wilhem Reich et de Fanon.
L’ébauche expérientielle et individuelle du ressentiment naît tout d’abord au moment de la petite enfance, lors de la première séparation avec la protection maternelle et de la frustration parentale qui en découle. L’éducation permet de préparer cette séparation, de l’enseigner avec les objectifs d’autonomie et de libération, d’interdépendance mais aussi de solitude réelle. En cela, acquérir des capacités de symbolisation permet cette libération. Cette capacité de représentation se trouve déficitaire dans le ressentiment. La psychopathologie du ressentiment prend ensuite sa source chez les enfants autour des troubles oppositionnels et provocateurs avec des sujets jeunes souffrant de troubles de déficit attentionnel et d’hyperactivité (DSM IV). Alors « le sujet ne peut plus se nourrir du regard sur les choses » (p. 89). Finalement, le ressentiment, ce pourrait être l’incapacité à admirer. C’est alors que les écrits de Freud permettent de faire le lien entre culture, civilisation et frustration sublimée comme répression libératrice, répression des pulsions instinctives et aliénantes. C’est bien parce que nous ne sommes pas faits que de pulsions primaires que nous pouvons faire culture et civilisation. Cette liberté, acquise par le biais de l’amer, permettrait de maintenir une initiative à l’intérieur d’un environnement qui n’est pas exclusivement le nôtre. Mais avec le ressentiment, on ne devient « que la faute d’un autre » (p. 80) et se dessine alors la dynamique de la passivité-agressivité.
Le ressentiment serait la maladie de la démocratie. Au sein de ce modèle politique où le rapport au concept d’égalité est déterminant et dans lequel les inégalités explosent, il existe un déferlement des passions victimaires et « ressentimistes ». Ainsi, le pont entre l’individu du ressentiment et le ressentiment collectif est fait. À cela, se rajoutent les conditions objectives de la souffrance au ressentiment collectif d’une société, expliquées par un sentiment d’insécurité globale (politique, économique, psychique…). Dans ce mouvement, le concept de réification vient complexifier l’affaire. Introduit une première fois en 1959 dans le marxisme, les mots « réification » et « réifier » signifient respectivement chosification et chosifier. Dans une pulsion de domination, l’autre est inscrit dans un régime de non reconnaissance et cette réification, amenant une reconnaissance manquée, créé le berceau du ressentiment. La reconnaissance serait l’antidote à la réification. Cette non-reconnaissance se retrouve dans le monde du travail, par exemple, et son processus de dénarcissisation opérée. Pour le traiter et se re-narcissiser : la consommation et le divertissement compensatoire en seraient les solutions illusoires.
Une autre voie se présente alors, celle du fascisme et du refoulement sexuel avec l’étayage des théories de Wilhem Reich : les masses humaines perdent le sens de la liberté par répression sociale de la sexualité génitale des petits enfants, des adolescents et adultes. Du consentement et de la servitude, naît l’incapacité de l’indépendance psychique et intellectuelle rendant, au final, impossible l’aptitude à la liberté et amène une tendance patriarcale de la vie sociale et personnelle. De là apparaît alors la tentation religieuse ou mystique (sublimation falsifiée).
Une grande partie du livre est consacrée à Frantz Fanon ainsi qu’à sa perpétuelle introspection sur sa place et son rôle en tant que soignant, psychiatre et victime de l’histoire coloniale. Un psychiatre qui aurait pu tomber dans le ressentiment face à l’amer de sa pratique et de son histoire, mais qui a su s’élever et conceptualiser sa lutte contre le ressentiment à travers les principes de forclusion et de déclosion. Pour Fanon, il faut « s’évader de sa race » (Fanon cité par Fleury, p. 206), autrement dit trahir sa propre cause en s’émancipant de sa propre souffrance. Il faut accueillir la plainte pour combattre le ressentiment. Dénoncer les blessures du nazisme et du colonialisme permet de soigner, en les faisant basculer du côté des crimes. Mais de la forclusion, soit de l’enfermement du sujet en geôlier de sa propre prison, il faut créer la déclosion, c’est-à-dire la sortie du « magma émotionnel dramatique qui produit des identités captives de leur culture » (p. 203). De la déclosion du monde, on s’extrait de la chosification.
Fleury rappelle enfin que pour Fanon, il faut faire prudence. Tout peut partir d’un inconscient collectif d’une imposition culturelle irréfléchie. Et de l’inconscient collectif et individuel naissent les névroses individuelles et collectives. Derrière tout ressentiment, il peut s’agir de « la grande douleur océanique du manque » (p. 215) et l’être devient dépendant de l’effondrement de l’autre.
À la différence de Jankélévitch, Fleury doute d’une possible réversibilité dans le ressentiment avec son désenchantement et son absence de sublimation, sa rationalisation et sa déterritorialisation, notion reprise du philosophe Angenot. La philosophe clinicienne prend le parti d’un sujet qui peut, responsable de son choix de refuser le ressentiment pour celui de « l’homme océan » d’Hugo ou de « l’Ouvert » de Rilke. Le jugement moral semble provocateur mais reste plein d’espoir, enlève tout pronostic de soumission. L’autoconservation « ressentimiste » n’est que résistance et peut être dépassée.
Au final, Ci-gît l’amer est une théorie : celle du « ci-gît la mère », soit de la séparation nécessaire du sujet d’avec ses parents et de sa demande de protection infinie du Père. Pour cela, éduquer et soigner doivent être les deux premiers leviers pour créer une société capable de se prévenir du ressentiment, du moins de savoir le dompter. Soigner et gouverner sont indivisibles : « Tel devrait être l’objet du gouvernement : œuvrer collectivement aux moyens de se débarrasser du gouvernement, même si, en dernière instance, celui-ci peut garder la puissance souveraine de l’arbitrage. » (p. 170). La folie des masses serait prévenue par un acquis du goût de l’amer, ces dernières développeraient ainsi des aptitudes protectrices à se représenter le monde. Le livre fait le travail que l’individu devrait faire sur lui-même : s’analyser en tant que sujet politique au sens aristotélicien. Comment se vivre et se penser en tant qu’animal politique face à la réification ambiante ? D’après Cynthia Fleury, le sujet a arrêté d’essayer de se comprendre. Elle rappelle enfin que « le psychisme n’est heureusement pas la loi exclusive pour expliquer l’univers humain. Il ne détient pas les clés des secrets de l’individu et de l’Histoire. […] mais que le déterminisme social, économique, culturel et/ou psychique ne gagnera jamais la partie de la compréhension d’un être et d’une société. » (p. 185).
© 2025 Editions La pensée sauvage - Tous droits réservés - ISSN 2259-4566 • Conception Label Indigo