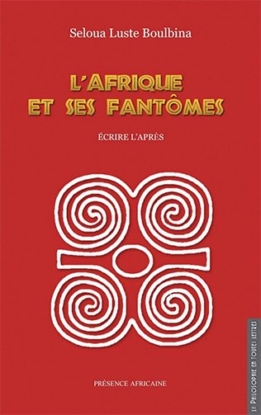
L'Afrique et ses fantômes, écrire l'après
La condition post-coloniale n’est pas seulement une situation politique et économique résultant des années de colonisation et des choix effectués par un pays devenu ensuite indépendant. Elle est aussi un type de relation à soi-même vécue par des personnes à qui des reconnaissances pourtant essentielles ont été déniées et qui ont bâti sur ces manques une subjectivité blessée. « Je parle des sujets car la colonie est la négation des individus en tant que sujets. La catégorie philosophique de sujet est pertinente pour aborder le sens et la nature de la décolonisation. »1
L’auteure prétend que le temps ne suffit pas à effacer les effets de la colonisation. L’onde de choc de certaines situations notamment des guerres d’indépendances et des guerres postcoloniales se fait encore sentir. Ces traumatismes pourraient durer encore longtemps si la méconnaissance de leur profonde empreinte n’est pas connue et prise en compte. La condition postcoloniale ne se comprend pas en terme d’héritage (positif) mais au contraire, d’absence, de vide, de manque-à-être, de devenir manifestement amputé de son acte (certes imprévisible mais clairement dévié, désorienté, sans préjuger de ce qu’il aurait été). L’auteure relève ce qui se transmet subjectivement et induit un devenir freiné et non exempt de contradictions…
Ainsi la langue officielle de l’Algérie est-elle aujourd’hui l’arabe littéraire. On pourrait croire que la parenthèse coloniale où le français avait été imposé au peuple colonisé est ainsi refermée, qu’une langue en exil est rentrée chez elle mettant fin à une aberration culturelle. Or, il n’en est rien : certes, l’arabe littéraire tient lieu de langue officielle, il résulte d’une standardisation qu’on retrouve partout, du Machrek au Maghreb. Ce choix met en évidence l’impossibilité d’admettre l’arabe dialectal algérien comme langue digne et entière. Il a eu, en effet, la faiblesse de se laisser hanter par un français inaudible symboliquement, et d’avoir été qualifiée d’abord de dialecte, de langue inaboutie, et à ce titre cette langue n’est pas enseignée même si elle est parlée. Mais l’Algérien s’exprimant en algérien, arabe dialectal transmis au sein des familles, continue à vivre une séparation linguistique sans réconciliation possible, sans lieu où se dire complètement, à tout le monde, directement ou par le biais de la traduction. « De plus, les Algériens – et ce n’est qu’un exemple – parlent arabe algérien, kabyle, tamacheck, français… Il n’y a pas qu’une seule langue. En outre, il n’y a pas de pays africain dans lequel la langue coloniale, et ses fantômes, ait été effacée ».
Ce lieu de réflexion qu’est la langue est un des points abordés par l’auteure pour nous amener à penser que le passé est une modalité du présent, dans les avatars qu’il est nécessaire de démasquer. Or rien de mieux que l’inconscient, personnel, linguistique ou historique, pour faire durer un passé traumatique et pourtant formateur. Il s’agit dans ce livre de suivre jusqu’à aujourd’hui, en partant des situations coloniales, les plis installés au creux desquels la dévalorisation de soi est devenue possible et répétitive, signifiante et admise pour/par les colonisés eux-mêmes.
« Toute la littérature du continent, dans toute sa variété et sa diversité, peut être considérée comme une prise de parole. Car ce que l’on impose aux sujets des colonies, c’est le silence. Le discours colonial est seul autorisé. Chacun doit se souvenir que l’origine de la guerre d’Algérie se trouve dans le préjugé français – jusqu’aux sommets de l’Etat – qu’en Algérie, il n’y avait pas, chez les Musulmans, « d’interlocuteurs valables », selon l’expression consacrée. Nier la capacité à parler, c’est nier non seulement l’humanité et la rationalité (voir Aristote) mais aussi et par conséquent la subjectivité. »




